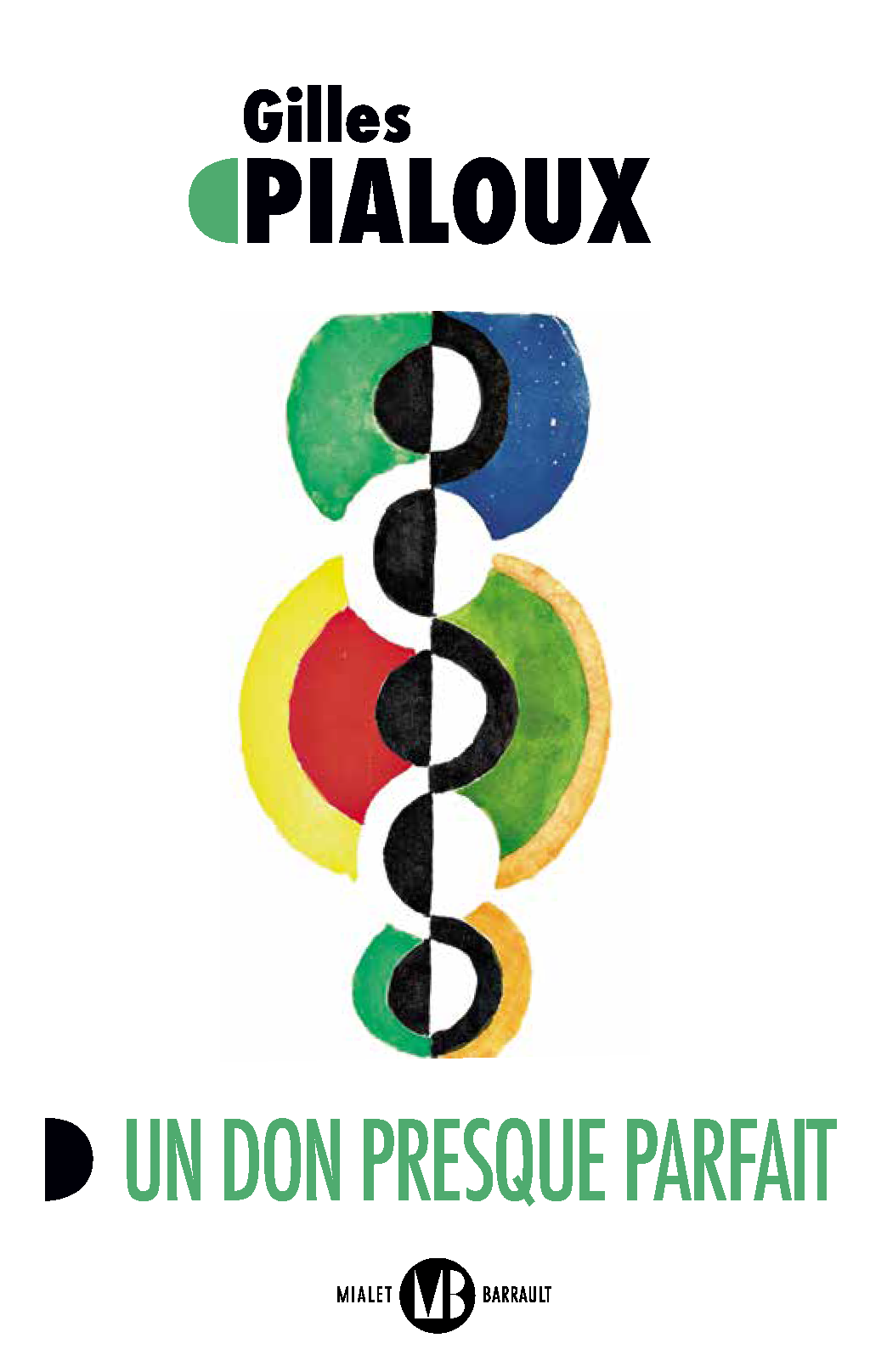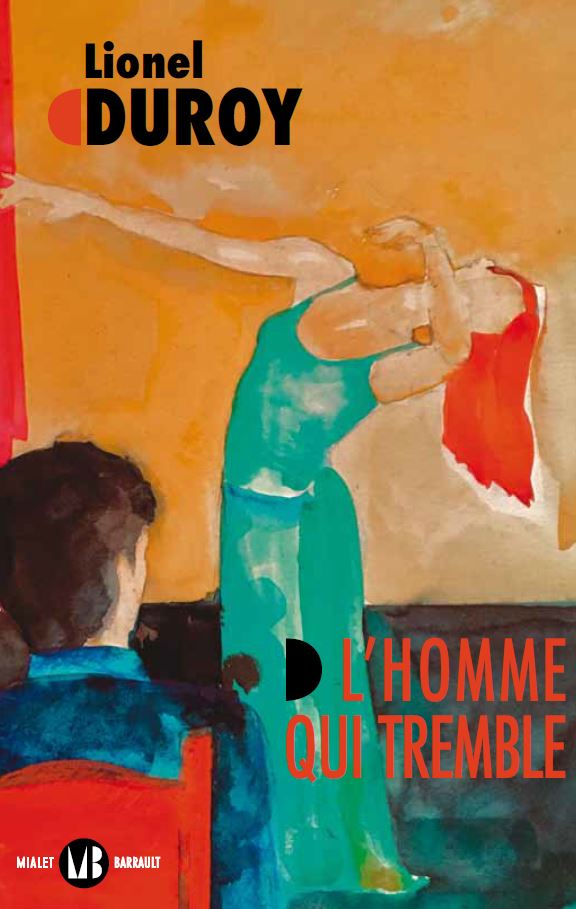Hôtel du Bord des Larmes
Elsa Flageul
En librairie dès le 3 mars 2021
Les divorce hotels promettent de divorcer en un week-end, sans tracas ni démarches interminables, dans un souci de médiation, de bonne humeur, et même de bien-être. L’Hôtel du bord des larmes est l’un de ces hôtels. En ce vendredi de début d’été, il accueille Cécile et François, désolés d’en arriver là, pas très convaincus par l’idée, mais bien décidés à rompre ce mariage tout en préservant leur fille : ce que l’amour a fait mourir, la famille qu’ils étaient les oblige à le laisser en vie. Au cours de ces deux jours, ils vont revivre les émotions qui les ont unis puis séparés, accepter de prendre leurs distances… et faire de nouvelles rencontres. Et ça, ce n’était pas prévu.
À travers les aventures touchantes et drôles de ses jeunes personnages, Elsa Flageul dessine un portrait acide et très subtil de la difficulté à vivre des nouvelles générations.


Elsa Flageul
Depuis son premier roman, J’étais la fille de François Mitterrand, paru en 2009, Elsa Flageul a publié Madame Tabard n’est pas une femme (2011), Les Araignées du soir (2013) Les Mijaurées (2016), en cours d’adaptation
pour le cinéma, et À nous regarder, ils s’habitueront (2019).
Hôtel du bord des larmes est son sixième roman.
Photo Pascal Ito © Flammarion
Extrait
Et pourtant, ils sont là aujourd’hui, dans cet hôtel. On les appelle les Hôtels du bord des larmes. Des hôtels où l’on divorce. Bien sûr, ils n’étaient pas obligés de venir ici pour le faire. Il y a d’autres façons, classiques, longues, moins coûteuses, et les enfants qui trinquent, tu préfères aller vivre chez papa ou chez maman, non merci. Et puis il y a eu un jour cette publicité dans les journaux, à la radio, sur Internet.
Les gens n’en revenaient pas, un hôtel pour divorcer, mais quoi encore. Des spécialistes, des intervenants, des chroniqueurs étudiaient le phénomène, on parlait de capitalisme des sentiments, de mercantilisme des rapports humains. Certains parlaient même de prostitution du chagrin d’amour, d’ubérisation de la séparation. Allons
bon. On trouvait ça abject, déprimant, où va le monde, dans quelle société vit-on, je vous le demande.
On se moquait des premiers inscrits. On les méprisait de ne pas arriver à se séparer tout seuls, comme des grands, proprement, comme si c’était facile, comme si personne, jamais, n’était devenu fou de désespoir par amour. Comme si personne n’avait jamais voulu s’arracher le coeur à main nue pour qu’il s’arrête de battre, effacer de sa mémoire les soupirs, l’odeur de la peau, le sexe qui se dresse, l’humidité et la chaleur des lèvres de l’autre. Comme si personne non, n’avait jamais voulu se faire éclater la cervelle pour oublier ces moments où l’autre les regardait avec admiration, désir, amour. Ce regard, oui. Ce qui avait été et ce qui n’était plus.
Ce que la vie avait gâché sans qu’on comprenne comment, ni pourquoi, cette absence de moment décisif, cette usure.
Ce désir qui s’efface, se dilue, s’évapore, quitte un corps un soir, puis un autre soir, puis un autre soir encore mais qui revient soudain, on se dit ça y est, il est de retour, j’ai eu peur, mais en fait non : un beau jour le désir est parti sans faire de bruit, sans claquer la porte, rien. Cet effacement.
Cette douleur-là. La même que celle des absents, absents à jamais. La même que celle de la voix qui perd de sa réalité, et l’abonnement téléphonique qu’on garde, malgré tout, juste pour pouvoir écouter encore la voix, sa voix, celle de celui qui n’est plus. La même douleur. Le même abîme.
Des photographes, des reporters allaient jusqu’à immortaliser les futurs divorcés entrant dans l’hôtel, aux journaux télévisés on passait des interviews, sur les réseaux sociaux les nouveaux divorcés faisaient des selfies, pouces levés et mines réjouies, big up à tous les divorcés ! On aimait aussi ceux qui ne pouvaient retenir leurs larmes et éclataient en sanglots face caméra, les vidéos circulaient sur la Toile, on riait d’eux, quelle honte de se montrer ainsi. Il fallait lire les commentaires des gens, l’exutoire que c’était, leur mépris, leur dégoût, leur fascination aussi. Ce déferlement comme ça, ça donnait la nausée. C’était notre monde, alors.
On parlait volontiers de stigmatisation, de victimisation.
Le chagrin ainsi montré, utilisé, et tous ces pauvres gens, des gogos crédules. Malgré tout, les futurs divorcés s’y pressaient, en deux jours c’était réglé, on pouvait passer à autre chose enfin, on effaçait pour mieux oublier, pensait-on.
En librairie dès le 3 mars 2021
Autres livres
chez Mialet-Barrault
À paraître le 12 avril 2023.
Les marranes sont les Juifs d’Espagne et du Portugal qui, au XVIe siècle, se sont convertis au catholicisme tout en continuant à pratiquer leur religion en secret.
Pour rendre compte de ce temps, Michèle Sarde a choisi de mettre en scène Doña Gracia, une femme étonnante qui joua un rôle considérable à cette époque troublée. Issue d'une riche famille de marranes, elle fut amenée très jeune à diriger la « banque » Mendes, rivale de celle des Médicis. Rois et princes empruntèrent sans relâche à la riche banquière en la menaçant sans scrupules de la livrer aux inquisiteurs. Avec une audace rare et une intelligence aigüe, Doña Gracia ne cessa de jouer avec le feu. Disséminés dans toutes les villes mar-chandes d’Europe, ses agents commerçaient activement et servaient de relais aux marranes en fuite. Le jour où le danger devint trop pressant et quand Charles Quint vou-lut la déposséder de sa fortune, elle décida de fuir Anvers. Alors commença un extraordinaire périple qui la conduisit jusqu’à Istanbul, où Soliman le Magnifique l'accueillit et la protégea. De la Corne d'or, elle osa boycotter le port d'Ancone, fief des États pontificaux, coupables d'avoir condamné les Juifs au bûcher.Silencieux et docile, Marcel n’a jamais eu, de toute sa vie, d’autres horizons que les murs de son usine. L’usine est assassine. Elle brutalise, humilie, écrase, dégrade, mutile. Dans ce roman singulier, à la fois cruel et tendre, Arthur Nesnidal utilise tous les styles d’écriture, de la prose au calligramme en passant par les formes les plus diverses de l’expression poétique et théâtrale pour expri-mer la solitude effrayante à laquelle sont condamnés cer-tains de nos contemporains.
Après un véritable parcours du combattant qui les a conduits en Amérique du Nord dans l’univers kafkaïen de la gestation pour autrui, David et Alessandro sont devenus les heureux parents de Léa et Diego, d’adorables jumeaux. Dix ans plus tard, la petite fille se retrouve porteuse d’une maladie orpheline et incurable. Seule une greffe de moelle peut la sauver. Mais comment retrouver la donneuse d’ovocytes, la seule qui soit absolument compatible, alors que tout a été fait pour qu’elle reste anonyme ? En partant d’un prélèvement de cellules de la joue de l’enfant et en passant au crible les bases internationales d’ADN, l’un des pères devra traverser la moitié du globe pour retrouver l’unique personne au monde qui puisse sauver sa fille.
Je tourne la page, et ça y est, la chose est enfin dite:« Dans un entretien, observe Nathalie Léger, Marguerite Duras s'énerve un peu : ''L'autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je ne comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive? Qui êtes-vous, allez-y, répondez-moi, hein?"» Qui je suis, moi ?