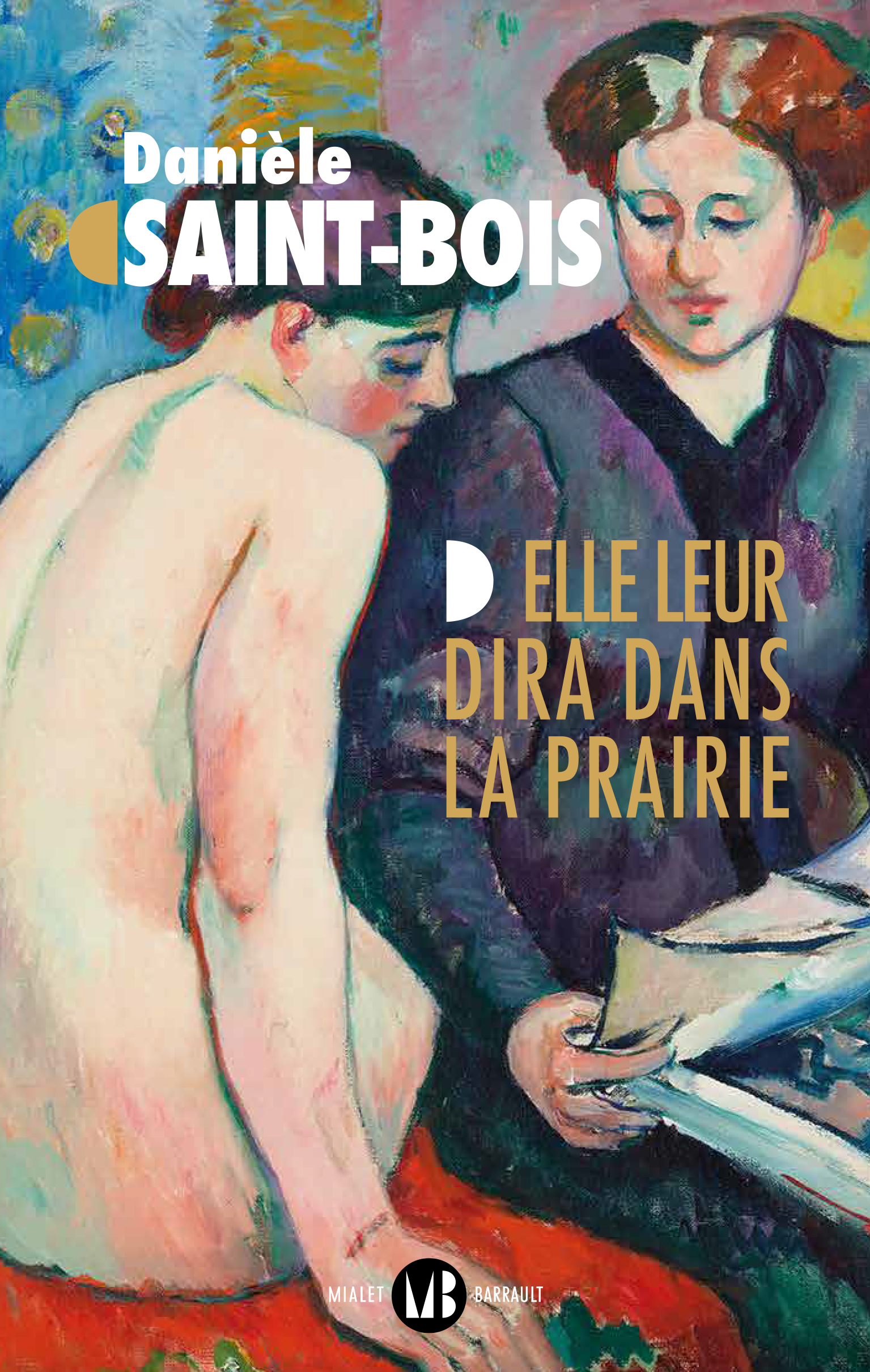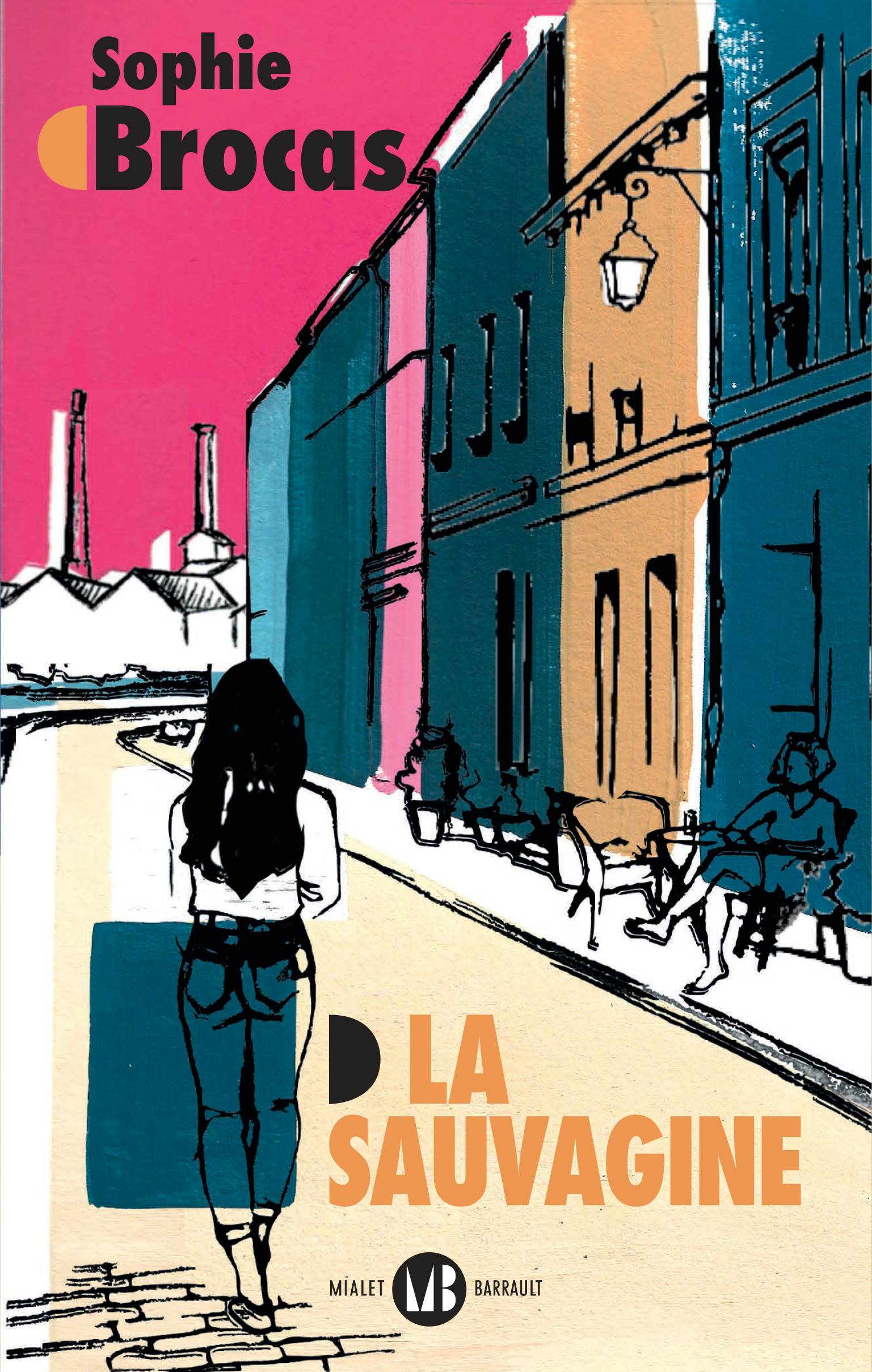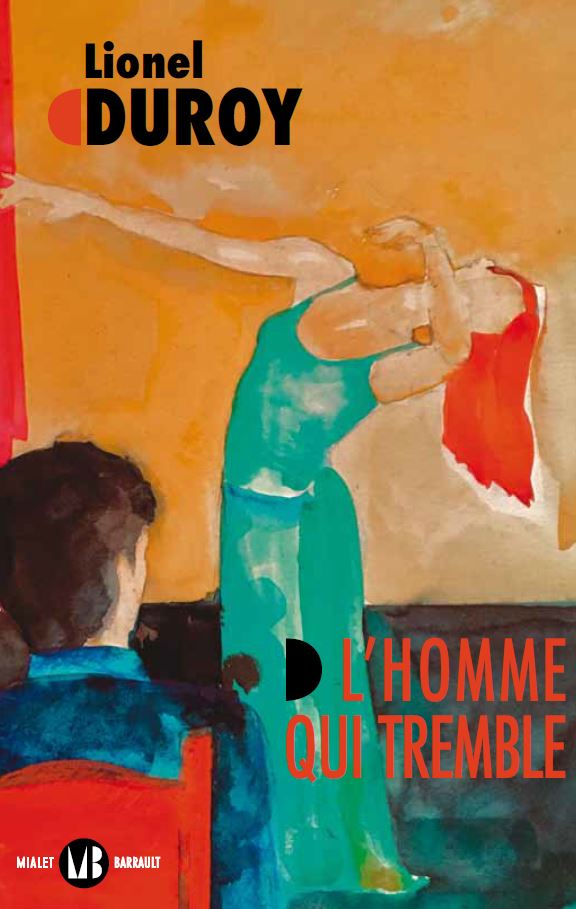La désinvolture est une bien belle chose
Philippe Jaenada
En librairie dès le 21 août 2024
Tandis qu’au volant de sa voiture de location, il fait le tour de la France par les bords, Philippe Jaenada ne peut s’ôter de la tête l’image de cette jeune femme qui, à l’aube du 28 novembre 1953, s’est écrasée sur le trottoir de la rue Cels, derrière le cimetière du Montparnasse. Elle s’appelait Jacqueline Harispe, elle avait vingt ans, on la sur nommait Kaki. Elle passait son existence Chez Moineau, un café de la rue du Four où quelques très jeunes gens, serrés les uns contre les autres, jouissaient de l’instant sans l’ombre d’un projet d’avenir. Sans le vouloir ni le savoir, ils inventaient une façon d’être sous le regard glacé du jeune Guy Debord qui, plus tard, fera son miel de leur désinvolture suicidaire.
Dans ce livre magnifique et totalement original, Philippe Jaenada a cherché à savoir, à comprendre pourquoi une si jolie jeune femme, intelligente et libre, entourée d’amis, admirée, une fille que la vie semblait amuser, amoureuse d’un beau soldat américain qui l’aimait aussi, s’est jetée, un matin d’automne, par la fenêtre d’une chambre d’hôtel.


Philippe Jaenada est l’auteur d’une douzaine de romans, dont Le Chameau sauvage (prix de Flore), La Petite Femelle et La Serpe (prix Femina).
Photo Pascal Ito © Flammarion
Extrait
La mer du Nord est basse sur la plage de Dunkerque. On dirait du Flaubert (si – ou du Maupassant) mais il n’y a pas dix-huit façons de le dire : à Dunkerque, c’est marée basse. Un mardi de février à 16 h 05, en 2023, je suis sur le sable de Malo-les-Bains, ancienne commune aujourd’hui rattachée à la ville, j’ai marché quelques pas pour m’approcher de l’eau mais vite renoncé, c’est trop loin – cent ou deux cents mètres, je ne sais pas, les distances sont plus difficiles à jauger quand il n’y a rien devant soi, que du sable et au loin l’eau.
Dans mon dos, à une cinquantaine de mètres, derrière la haute fenêtre en bow-window du deuxième étage de la villa Les Tamaris, sur la promenade, la digue de Mer, Pauline Dubuisson est debout, elle vient de se rhabiller, le jeune soldat allemand qu’elle rencontre ici régulièrement l’après-midi est encore nu sur le lit, elle a quinze ou seize ans. Elle voit exactement la même chose que moi en ce moment (ou marée haute, peut-être), en 1943. […] Je suis venu à Dunkerque pour voir le décor de son enfance et de sa jeunesse, la maison où elle est née et a grandi, 6 rue du Maréchal-Pétain, aujourd’hui rue des Fusillés, les rues qu’elle parcourait légère et sans soutiengorge, et la jolie villa Les Tamaris, blanche et vert amande, étroite, sur la digue de Mer.
J’étais resté à Paris pendant l’écriture du livre dans lequel je racontais la vie de Pauline, car je craignais, en m’immergeant dans le décor de ses premières années, de me laisser imbiber par l’émotion (je me connais, je tourne vite neuneu) et, dans le texte, d’ajouter malgré moi du sentimentalisme mièvre à une histoire déjà bien pathétique. C’est la première fois que je viens à Dunkerque, j’ai attendu huit ans, je ne crains plus rien. J’ai décidé de partir à l’improviste, je tournais en rond à Paris, je n’avais rien à faire, j’ai loué une voiture chez Avis à la gare du Nord, une Ford Kuga noire, réservé une chambre à l’hôtel Merveilleux (forcément plus attirant qu’un hôtel Épouvantable), sur la digue de Mer, à quelques mètres de la villa Les Tamaris, et je rêvasse maintenant sur la plage immense, je me suis accroupi pour toucher le sable. […]
Mais je me rends compte que lorsque je regarde vers la mer, en imaginant les bateaux anglais qui s’éloignent, ce n’est plus seulement à Pauline Dubuisson que je pense : au milieu des bombes, je vois tomber une fille presque nue, elle tombe du ciel et disparaît dans l’eau. J’avais en tête depuis des mois l’image de cette jeune femme qui tombe en culotte noire (du cinquième étage d’un hôtel miteux), c’était devenu non pas une obsession, je suis sain d’esprit, mais une pensée récurrente, presque permanente, elle tombait, elle tombait, jeune, belle, brune, pâle ; ces derniers temps, c’était passé, je l’oubliais ; elle revient ; plus je regarde vers le large, le ciel, plus je la vois tomber, et tomber encore.
Je sais très peu de choses d’elle, et je pense qu’il sera impossible d’en découvrir beaucoup plus – elle est morte il y a bien longtemps, en 1953, à vingt ans, juste une fille inconnue qui se jette par la fenêtre. J’ai pu trouver quelques informations sur son suicide, et les témoignages flous et parfois contradictoires de certains de ses amis (elle fréquentait un bistrot d’habitués à Saint-Germain-des-Prés), mais tout le reste, l’essentiel, semble définitivement perdu dans le passé, englouti. J’avais fini par me dire qu’il fallait probablement la laisser dans cette brume épaisse et froide qui absorbe tout. Mais elle est toujours là, elle continue de tomber.
En librairie dès le 21 août 2024
Autres livres
chez Mialet-Barrault
Tout va bien pour Souheila. Ou, plus exactement, rien ne va mal. Alors, qu’est-ce qui la pousse à entrer dans ce salon de massage thaïlandais à deux pas de chez elle, qu’elle n’avait jamais remarqué ? Et pourquoi n’en parle-t-elle à pas Rémi, l’homme avec qui elle partage sa vie ? ...
Quelle heure est-il ? Ils ont dit treize heures. Dans huit heures exactement. Exactement je n’en sais rien. Exactement ce serait à la seconde près. Au millième de seconde près. Tous ces mots que l’on emploie par facilité, alors qu’on ne sait rien ! On suppose, on certifie, on croit que… quelle fumisterie ces mots-là.
La vie est ironique. À quoi sert de gagner au loto quand on vous apprend que vous êtes atteinte d’une leucémie ? Née dans une petite ville industrielle que la crise a dévastée mais qu’une bande de citadins chics s’est mis en tête de coloniser, Mado voit son univers s’effondrer. Une greffe osseuse peut la sauver. Sauf que le seul donneur compatible est son frère aîné, Léon, à qui elle ne parle plus depuis longtemps. Avec intelligence, courage et détermination, Mado démontre magnifiquement que la vie est un combat que certains savent ne pas perdre.
Je tourne la page, et ça y est, la chose est enfin dite:« Dans un entretien, observe Nathalie Léger, Marguerite Duras s'énerve un peu : ''L'autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je ne comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive? Qui êtes-vous, allez-y, répondez-moi, hein?"» Qui je suis, moi ?